
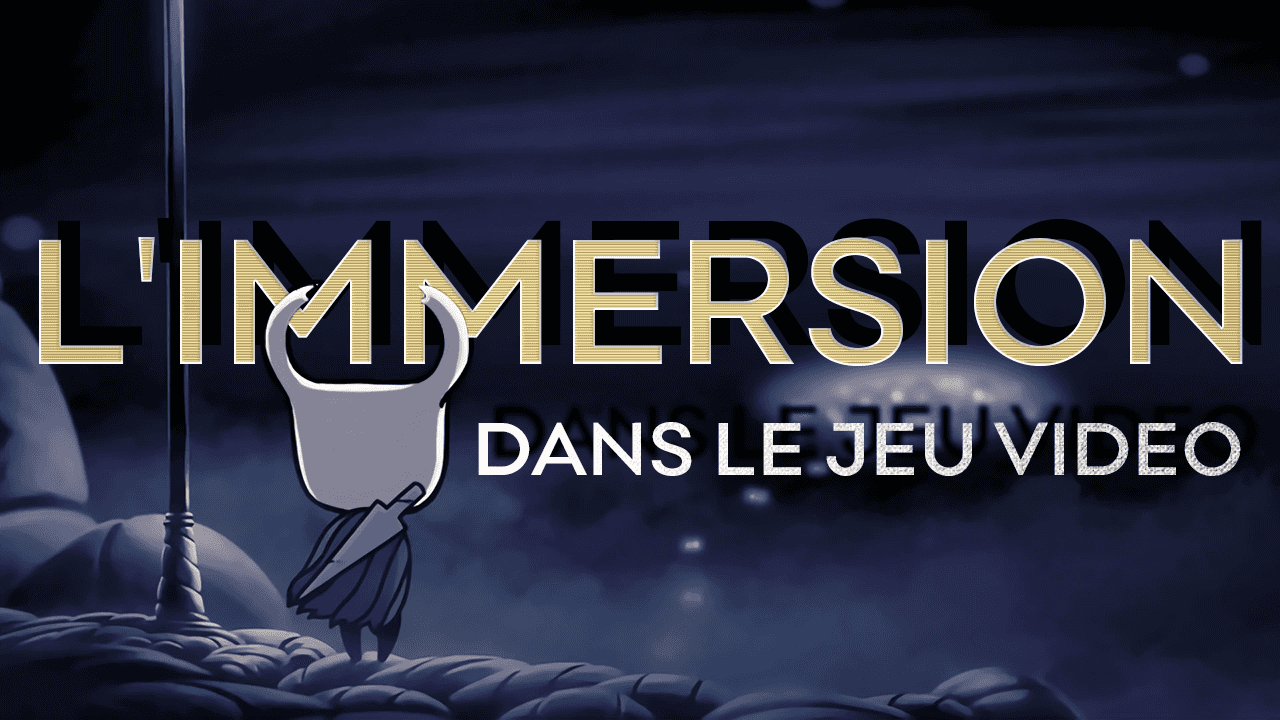
« Vous êtes là, rien ne se tient entre vous et la croyance que vous êtes dans un monde alternatif » disait Warren Spector, créateur du studio Looking Glass (connu principalement pour System Shock et Thief). Si le terme « immersion » est aujourd’hui galvaudé, souvent utilisé à tort et à travers dans le marketing, il n’en reste pas moins une qualité déterminante dans un jeu vidéo. Après tout, qui n’a jamais joué à un jeu pour s’évader ? Qui n’a jamais voulu vivre de grandes aventures et parcourir des mondes fantasmés et fantastiques ? Se sentir tout-puissant ? En étant le médium qui donne la possibilité au joueur d’avoir un impact direct sur ce qui se déroule à l’écran, le jeu vidéo est le parfait candidat pour une immersion sans pareil.
L’immersion, qu’est-ce que c’est ?
Avant de s’intéresser à l’immersion dans le jeu vidéo, il me semble nécessaire de recontextualiser le sens du terme et son utilisation. Dans son livre Hamlet on the Holodeck, Janet Murray explique que le mot « immersion » est employé pour décrire le sentiment d’être transporté dans un environnement simulé. Il est bien entendu appliqué de manière métaphorique, puisqu’il signifie littéralement « être submergé dans un liquide ». Une définition qui rejoint celle donnée par le Larousse, caractérisant l’immersion comme étant le « fait de se retrouver dans un milieu étranger sans contact direct avec son milieu d’origine ». Ces deux définitions mettent en avant une notion fondamentale de l’immersion : elle est totale ou elle n’est pas.
L’immersion n’est donc pas l’apanage de la fiction, mais bien de l’art en général. La littérature, le cinéma, le jeu de rôle, la musique, la peinture et tout autre médium peuvent procurer cette même sensation. Un lecteur, par exemple, peut complètement s’immerger dans le récit qu’il est en train de lire, comme le raconte Marcel Proust : « Il n’y a peut-être pas de jours de notre enfance que nous ayons si pleinement vécus que ceux que nous avons passés avec un livre préféré ». À l’instar de certains joueurs, il considérait les activités sociales comme une gêne, et voyait les repas comme des parenthèses qui le maintenaient éloigné de son activité favorite.
L’immersion fictionnelle
Et justement, il existe une sous-catégorie de l’immersion nommée l’immersion fictionnelle. Dans son livre Qu’est-ce que la fiction ?, Jean-Marie Schaeffer, directeur de recherche au CNRS, la définit comme l’acceptation d’une personne à se laisser volontairement tromper par les illusions fictionnelles, tout en gardant une certaine distance avec elles pour éviter d’acquérir de fausses croyances. Une spécificité qui l’éloigne de l’immersion au sens large du terme, car elle n’a de consistance que dans la conscience du sujet. Ce dernier peut ou non faire abstraction du monde qui l’entoure, mais ne cesse dans tous les cas de faire des allers-retours entre le monde réel et le monde fictif. Des éléments extérieurs pouvant interférer, comme des bruits de pop-corn au cinéma, la luminosité de la pièce, une douleur physique ou des pensées parasites.
Caractéristique unique de l’immersion fictionnelle, cet entre-deux entre la réalité et la fiction est qualifié de « biplanaire » par Jean-Marie Schaeffer. Selon lui, la fiction provoque une division entre notre capacité à percevoir les représentations et notre capacité à les vérifier : ce qui n’est pas possible le devient. Une spécificité qui rejoint la définition de la « suspension consentie de l’incrédulité », concept inventé par Samuel Coleridge. Il est défini comme « l’opération mentale effectuée par le lecteur ou le spectateur d’une œuvre de fiction qui accepte, le temps de la consultation de l’œuvre, de mettre de côté son scepticisme ». Un principe qui peut bien entendu s’étendre à toute œuvre de fiction.
Pour bien comprendre comment marche l’immersion dans le jeu vidéo, on va se concentrer dans cet article sur les travaux de quatre chercheurs en particulier. Dominic Arsenault et Martin Picard d’un côté, Laura Ermi et Frans Mäyrä de l’autre. Leur travaux ont permi de définir différentes catégories d’immersion, qu’on va découvrir dès maintenant. Si jamais vous voulez jeter un oeil à leurs articles, Vous trouverez toutes les sources dans la description.
L’immersion par les sens
Pour qu’un art puisse nous affecter, il doit nécessairement utiliser un de nos sens disponibles. Certains en utilisent même plusieurs, à l’image du cinéma et du jeu vidéo.
L’immersion sensorielle
Développée dans le SCI-Model, l’immersion sensorielle correspond à la capacité technique d’intéresser le joueur, par des stimuli audiovisuels dont l’intensité surpasse celle des informations sensorielles du monde physique. Elle proviendrait donc des conditions dans lesquelles on joue à un jeu vidéo : un grand écran entouré de haut-parleurs qui balancent des décibels à la pelle ne peut qu’immerger le joueur dans sa fiction. Qui remarquerait la présence d’une guêpe sur un écran de cinéma ? Dans de bonnes conditions, toute information du monde réel – liée à la vision ou à l’ouïe – est reléguée au second plan, permettant au joueur de se concentrer essentiellement sur la fiction.
Arsenault et Picard approfondissent ce concept en définissant trois sous-catégories de l’immersion sensorielle :
- L’immersion viscérale consiste à brouiller les repères du joueur en provoquant un sentiment vertigineux. Un concept que l’on retrouve dans l’essai Les Jeux et les Hommes de Roger Caillois. Il définit différents types de jeux, avec l’agon (la compétition), l’alea (la chance), le mimicry (le simulacre) et l’ilinx (vertige). Ce dernier est défini comme « la poursuite du vertige et consiste en une tentative de détruire pour un instant la stabilité de la perception et d’infliger à la conscience lucide une sorte de panique voluptueuse. Dans tous les cas, il s’agit d’accéder à une sorte de spasme, de transe ou d’étourdissement qui anéantit la réalité avec une souveraine brusquerie ». Une définition qui caractérise les expériences à sensations fortes, comme des montagnes russes, de l’alpinisme, etc. Elles provoquent chez le joueur une sensation d’ivresse par la déstabilisation de ses repères habituels. On retrouve ici le principal ressort de l’immersion viscérale, qui cherche à désorienter le joueur, que ce soit par la vitesse ou des effets visuels riches. On peut par exemple citer F-Zero, qui demande une concentration hors norme tout en faisant défiler des décors à une vitesse folle; Hexagon qui exige une précision millimétrée dans des environnements déstabilisants; ou encore certains types de FPS (appelés Fast-FPS) comme Doom ou Quake, basés sur l’intensité.
- L’immersion contemplative, quant à elle, cherche à immerger le joueur par la beauté artistique des environnements. Que ce soit grâce à un parti pris visuel léché ou à une excellente technicité graphique, la contemplation des décors pousse le joueur à s’investir émotionnellement dans le jeu. Des titres comme Journey, Final Fantasy ou Shadow of the Colossus représentent parfaitement cette utilisation des décors pour époustoufler le joueur. Même si elle est n’est pas une condition indispensable à l’immersion contemplative, la capacité d’un monde à coupler la liberté d’action avec de beaux décors offre au joueur l’impression d’être dans un monde tangible – et c’est bien pour cette raison qu’une grande partie des AAA sont de magnifique open world.
- Enfin, l’immersion kinesthésique concerne l’aspect sensori-moteur des jeux privilégiant la performance physique. Une immersion spécifique à des interfaces particulières, avec par exemple le tapis de sol utilisé pour Dance Dance Revolution, la guitare pour Guitar Hero, ou plus communément la Wiimote et le Nunchuk utilisés pour la Wii. C’est bien entendu une immersion spécifique, qui représente qu’une infime partie de l’industrie vidéoludique. Néanmoins, elle correspond parfaitement à l’immersion sensorielle, qui relie le joueur et le jeu à travers des sensations physiques.
La question du réalisme visuel
Une chose est sûre : un jeu à la pointe technologique aura moins d’efforts à fournir sur les autres mécaniques d’immersion pour emporter le joueur. Par exemple, Red Dead Redemption 2 utilise le réalisme de son gameplay comme mécanique immersive, avec une tonne d’actions possibles – parfois au détriment de l’ergonomie, une même touche correspondant à une action différente en fonction du contexte. Mais c’est avant tout ses environnements et leur incroyable technique, les animations, les visages réalistes et tous les détails anodins qui forment le principal vecteur d’immersion. Plus les graphismes sont réalistes, plus l’illusion de la réalité est grande. Si The Last of Us 2 a autant marqué les esprits – en bien comme en mal – c’est en grande partie par sa violence visuelle induite par le réalisme des personnages. L’identification est d’autant plus forte, et d’autant plus douloureuse lors des scènes violentes. On pourrait se demander si le photoréalisme ne va pas parfois trop loin avec des jeux au paroxysme de la violence comme Mortal Kombat, mais ça, c’est un autre sujet.
« Le visuel c’est le premier contact », déclare Sébastien Mitton, directeur artistique de Dishonored 2, qui ne parle pas du film de Denis Villeneuve. « Les gens s’attendent à voir un produit aussi beau qu’un film mais avec en plus la liberté de se balader où ils veulent ». L’éclairage, en particulier, conditionne la qualité du rendu. « Cela compte pour 50% de la qualité des graphismes », continue-t-il. « L’immersion c’est plein de petits éléments, comme quand un personnage passe devant le soleil et que la lumière du soleil est visible à travers ses oreilles ». Le directeur artistique explique que le moteur graphique, à ce titre, joue pour beaucoup. « Le moteur ne joue pas que sur le rendu, mais aussi sur l’IA, le son, tout ».
C’est donc une évidence, la qualité technique d’un titre influe sur sa capacité à embarquer le joueur dans son univers. Mais se contenter de beaux graphismes reste insuffisant pour maintenir le joueur immergé. Cyberpunk 2077 représente l’exemple parfait d’un jeu visuellement incroyable et pourtant doté d’imperfections en termes d’immersion. À sa sortie, les bugs étaient légion. Et on le sait tous, rien de pire qu’une voiture qui s’envole sans raison ou un PNJ en T-pose pour briser l’illusion de réalité. Mais au-delà de ces problèmes qui finiront par être résolus à travers les mises à jour, la structure même de la narration pose des problèmes d’immersion.
Mais surtout, placer le débat de l’immersion autour des graphismes photoréalistes le centre injustement autour des rares studios capables de les produire. L’industrie vidéoludique grossit de jour en jour – en 2020, 178 jeux étaient publiés sur Steam chaque semaine – et seuls quelques studios avec des centaines, voire des milliers d’employés peuvent se permettre d’imaginer des jeux comme Cyberpunk 2077, The Last of Us II ou GTA V. Dans ce cas, quid des jeux en cel-shading ? Du pixel-art ? Des visuals novels ? Chacune de ces catégories ne bénéficie que rarement d’un budget aussi conséquent que celui d’un AAA, et toutes disposent pourtant de mécaniques immersives très efficaces. Un des exemples les plus marquants reste pour moi To The Moon, qui, au-delà de son pixel-art grossier, m’a vraiment accroché à ses personnages et scotché à son histoire. Simplement grâce à la qualité et la subtilité de son écriture.
Ce ne sont pas les testicules des chevaux dans Red Dead Redemption 2 qui m’ont transporté dans son far-west dépaysant. Ce ne sont pas les mouvements des cheveux de Geralt de The Witcher 3 qui en font l’un des meilleurs jeux de sa génération. Bien sûr, ces détails peuvent aider l’univers à être crédible, et tant mieux s’ils sont présents – du moins quand la somme de ces détails n’oblige pas les développeurs à subir un crunch terrifiant. Toutefois, dans une industrie qui cherche à toujours aller plus loin dans le réalisme visuel, il devient de plus en plus nécessaire de prendre du recul et d’aborder correctement ce que l’on attend d’une expérience vidéoludique, sans mettre de côté les différentes couches qui composent un jeu vidéo comme le gameplay et la narration.
L’immersion par la narration
Arsenault et Picard subdivisent l’immersion imaginative en trois sous-catégories. Crée par l’exploration d’un monde virtuel, l’immersion diégétique renvoie à l’impression d’être présent dans l’univers fictionnel d’un jeu. Bien entendu, plus le lieu semble familier, plus le sentiment sera fort chez le joueur – Flight Simulator en est le parfait exemple. L’immersion narrative, quant à elle, correspond à la captivation créée par le récit et l’impatience de connaître son dénouement. Elle est liée aux stratégies narratives mises en place dans le jeu, ainsi qu’au désir qu’a le joueur de faire progresser l’histoire. Enfin, l’immersion identificatrice surviendrait pour sa part lorsque le joueur a l’impression d’incarner son personnage ou lorsqu’il établit un lien d’attachement fort avec lui.
L’immersion diégétique
L’immersion diégétique correspond à l’impression d’être présent dans un univers fictif à travers la familiarisation du joueur avec la géographie du jeu et la structure des lieux qu’il y découvre. Une imprégnation qui serait notamment influencée par la qualité et la quantité des détails fournis. Par exemple, les immersives sim – dont le nom donne le ton – sont des jeux qui cherchent à créer un monde cohérent, où les éléments n’existent pas pour servir le joueur, mais pour approfondir l’univers. Pour se faire, les développeurs peuvent éparpiller un nombre de détails impressionnants. Dans le jeu Prey, il est possible de trouver des informations sur les 250 personnes qui composaient l’équipage, sans que cela ne serve aucunement le joueur à progresser. Ils peuvent aussi créer un monde donnant l’impression d’exister sans le joueur, lui conférant ainsi une certaine consistance.
Dans Dishonored, un joueur inattentif ira chez le marchand d’armes pour acheter de l’équipement et repartira aussitôt. Mais un joueur curieux pourra apprendre son nom (Horatio Wetherby), aller chez lui, et découvrir qu’il cherche à recruter un assistant après que le précédent soit mort dans de mystérieuses circonstances. Assistant que l’on peut croiser dans une maison où l’on rencontre un infesté, et apprendre qu’il a été licencié car il s’opposait aux pots-de-vin que Horatio donnait aux autorités. On y trouve une clé, qu’on peut utiliser pour voler le marchand d’armes. Tout ça ne sert à rien dans le scénario. Certes, on peut récupérer un meilleur équipement, mais Arkane aurait aussi pu simplement mettre la clé derrière le comptoir du marchand. C’est là toute la puissance des immersive sim et tout le savoir-faire d’Arkane : créer un monde crédible, rempli de PNJ avec une histoire et une personnalité vraisemblable.
Les limites tangibles d’un monde virtuel sont elles aussi vectrices d’immersion, ou peuvent à l’inverse les briser. Voir son avatar faire des sauts inhumains pour finalement être bloqué par une barrière qui lui arrive aux hanches ne peut qu’engendrer frustration et incompréhension. Les murs invisibles permettent aux level designers de délimiter les frontières d’un niveau mais diminuent considérablement l’immersion spatiale. C’est bien pour ça qu’un jeu comme Zelda Breath of The Wild a autant marqué les esprits : chaque élément de décor est accessible, tandis que n’importe quelle surface peut être escaladée – excepté les gens, faut pas pousser non plus. La montagne que l’on voit au loin existe physiquement dans le jeu et n’est pas qu’un décor lointain, on peut l’atteindre et grimper à son sommet. Tandis que le canyon sans fond qui entoure la zone de jeu établit une limite tangible et mystérieuse. Il entretient ainsi l’intérêt du joueur tout en conservant une cohérence globale.
Dans un autre registre, Death Stranding est lui aussi un jeu qui réussit ingénieusement à conserver un univers crédible. Et il fait même plus que ça : lorsque l’on voit les monts enneigés au loin, on commence déjà à craindre leur ascension avec deux bouts de ficelles et trois échelles cabossées. On s’imprègne d’ores et déjà des difficultés à venir, on se projette dans un futur effrayant, tout en ayant une pointe d’excitation des défis à relever. En somme, on s’investit émotionnellement simplement en apercevant un élément de décor, qui ne serait dans d’autres jeux qu’un simple fichier PNG. Certes, utiliser la topographie du terrain pour rendre son univers immersif est loin des canons habituels de l’amusement, mais qui a dit que le jeu vidéo devait être nécessairement fun pour être immersif ?
L’immersion narrative
Au début des années 2000, un débat divisait les narratologistes et les ludologistes. Les premiers croyaient en la possibilité d’utiliser les concepts narratifs pour étudier les récits vidéoludiques, tandis que les seconds considéraient les éléments narratifs comme insuffisants pour analyser le jeu vidéo par le seul biais de la narration. Cette discordance a eu un grand impact sur la manière d’aborder la narrativité du jeu vidéo. On en voit aujourd’hui le résultat : la plupart des théoriciens s’accordent à dire qu’un monde fictionnel motive le joueur à atteindre l’objectif défini. L’interactivité sert le récit et ne n’exclut aucunement sa possibilité d’existence.
Arsenault et Picard vont quant à eux plus loin en déclarant que le récit et l’avatar sont à la base de la jouabilité, car ils justifient et délimitent les actions du joueur. L’immersion narrative décrit le phénomène où le joueur devient absorbé par l’histoire, ou lorsqu’il s’identifie et s’attache émotionnellement à un personnage – le plus souvent son avatar. Cette définition implique donc que le joueur se sente transporté dans la diégèse du jeu par le biais de l’histoire, des personnages et des représentations. Elle repose sur la plausibilité de l’univers fictionnel, la crédibilité des personnages, la familiarité du spectateur avec les conventions employées, la cohérence des événements et le déploiement de stratégies visant à renforcer l’effet de tension, de joie, de tristesse, etc.
Mais la narrativité dans le jeu vidéo reste une variable, qui va dépendre du jeu en lui-même, de son genre et de l’intention des développeurs. Les chercheurs ont définit trois prototypes narratifs :
- Le jeu endo-narratif, un contenu narratif faible. Dans cette catégorie se trouvent les jeux au scénario relégué au second plan pour mettre en avant le gameplay.
- Le jeu à récit complet, ouvert ou fermé. Cette catégorie de jeu se rapproche le plus de la littérature ou du cinéma. Ici, l’intrigue est placée au premier plan, donnant au joueur l’impression qu’il est dans une une intrigue ficelée par une continuité spatiale.
- Le jeu évolutif. Il correspond aux jeu dont la narration s’éloigne des récits habituels, où le joueur n’est plus guidé par une trame narrative jusqu’à un climax mais laissé en liberté par les possibilités d’interactions. On peut notamment citer les MMORPG et les jeux bac à sable comme Minecraft.
Les jeux endo-narratifs et évolutifs n’étant pas pertinents pour analyser l’immersion à travers la narration, nous allons nous concentrer sur les jeux à récit complet et commencer par le récit fermé. Dans ce type de narration, la progression est divisée en épisode ou en chapitres, qui ne possèdent tous qu’un seul dénouement possible. Le climax est atteint à la fin, généralement lors d’un combat de boss. Les actions s’accumulent à travers de nouvelles capacités, de nouvelles armes, de niveaux, etc. La temporalité est donc centrale dans l’impression de progression. Le tout est entrecoupé par des cinématiques qui aideront le joueur à percevoir l’unicité du récit. Ce sont elles qui créent l’immersion narrative, car leur seul but est de raconter l’histoire, en opposition aux phases de gameplay qui ne possèdent généralement que peu d’éléments narratifs.
C’est d’ailleurs lors de décalages trop important entre le scénario et le gameplay que peut apparaître un fléau pour l’immersion : la dissonance ludonarrative. Le terme fut inventé en 2007 par Clint Hocking dans un article sur son blog où il évoque le problème sur Bioshock. Il explique que le jeu propose deux contrats au joueur. Le premier, ludique, correspond aux valeurs de l’objectivisme Randien et nous pousse à être égoïste. Le deuxième, narratif, impose d’aider Atlas pour progresser. Le titre ne nous laisse aucunement choisir entre les deux et crée donc une dissonance ludonarrative. Depuis, de nombreux exemples mettent en avant cette dissonance ludonarrative, comme Uncharted où on joue un mec sympa comme tout qui dézingue des milliers d’individus ; Tomb Raider (le reboot de 2013) où Lara Croft est présentée comme inexpérimentée et fragile mais réussit pourtant à aligner les headshot sans problème ; ou encore la capacité d’avoir une flèche téléguidée dans Assassin’s Creed Origins. La liste est très longue, et s’expliquent par le fait que les développeurs cherchent avant tout à mettre en avant l’aspect fun du gameplay, bien plus que la cohérence entre celui-ci et l’histoire. Même des jeux plus narratifs – comme Heavy Rain – peuvent créer cette dissonance, pour maintenir un mystère et créer un twist plus impactant.
L’objectif est donc d’accentuer l’immersion en donnant un sens narratif aux actions endo-narratives. Dans Le sens de la fiction ludique : jeu, récit et effet de monde, Antoine Dauphragne explique que « là où le jeu pourrait fonctionner sans ajout d’imaginaire, là où son système de règles suffirait à alimenter la situation ludique, on introduit malgré tout un univers ou un récit ».
Généralement, les jeux à récit complet se concluent sur un dénouement déjà connu du joueur – la victoire du protagoniste. Le plaisir réside en réalité dans le « suspense moyen », les circonstances qui mèneront au dénouement attendu. On sait qu’on va gagner, mais ce qui rend le scénario intéressant, c’est de savoir comment on va y parvenir. Du moins, pour les jeux à récit fermés, car ceux à récit ouvert appliquent plutôt la théorie des possibles narratifs, qui consiste en « une série d’embranchements binaires consacrant le déroulement ou le non-déroulement d’une possibilité, d’une virtualité ». Une définition développée par Baptiste Campion dans son article [Vers l’actualisation d’un « récit fantôme » ?](Baptiste Campion, « Vers l’actualisation d’un « récit fantôme » ? »), qui explique que la présence de choix multiples donne lieu à la création d’intrigues complexes. La capacité du joueur à choisir entre différents embranchements permet ainsi de donner vie aux « récits fantômes », ces pans d’histoires imaginés mais jamais racontés.
Les jeux Telltale, Quantic Dream ou les Life is Strange sont de bons exemples de jeux à récit ouvert. Par exemple, dans Heavy Rain, le joueur incarne 4 personnages à tour de rôle dans une histoire centrée sur un tueur en série qui a kidnappé l’enfant de l’un de ces protagonistes. Le jeu propose 18 fins différentes en fonction des choix, et certains personnages peuvent même mourir prématurément. Le studio de David Cage a poussé le concept à son paroxysme avec son dernier jeu, Detroit Become Human, qui dispose du chiffre impressionnant de 99 fins possibles. Même les jeux plus linéaires se sont mis à proposer des choix pouvant altérer l’histoire : c’est par exemple le cas de Call of Duty : Black Ops II, dont la campagne peut se terminer de 8 manières différentes. Néanmoins, et à l’instar des jeux Telltale qui ont essuyé beaucoup de critique à cause de ça, les changements restent superficiels et n’impactent que quelques lignes de dialogues. Clémentine ne peut pas mourir dans The Walking Dead; L’enquête suivra son cours quoiqu’il arrive dans Wolf Among Us et vous ferez toujours les missions dans le même ordre dans Black Ops II.
Dans ce genre de cas, la narrativité ouverte sert principalement d’argument pour mettre en avant la durée de vie du jeu. Face à tel ou tel choix – qu’il soit minime ou non – on sera tenté d’explorer les conséquences de nos choix, qu’ils arrivent au même dénouement ou non. D’ailleurs, si vous êtes intéressés par le sujet, The Stanley Parable est un excellent jeu qui tourne intelligemment en dérision ce concept de jeu à choix. Avec ses 19 fins et les conditions parfois ubuesques pour les atteindre, le jeu met en avant l’aspect superficiel des choix à travers l’écriture du narrateur et ses interactions avec le joueur. Certes, le jeu ne dispose pas d’un gameplay poussé, mais il remet en question une pratique devenue courante et souvent plus utilisée comme un gadget que comme un réel choix de narration.
L’immersion narrative demande donc aux scénaristes de créer une histoire intrigante, qui donne envie au joueur de s’investir pour voir sa résolution. Pour se faire, le plus simple reste les jeux d’enquêtes, dont la conclusion scénaristique repose sur la résolution d’un mystère. Disco Elysium, Her Story, les Ace Attorney ou encore Obra Dinn en sont de bons représentants. Il faut comprendre les personnages, les enjeux, voire la politique de ces mondes fictifs pour réussir à démêler le vrai du faux. Le cas de Paradise Killer s’avère particulièrement intéressant, car le jeu se conclut par un procès dont la vérité ne sera qu’une affaire de preuves. Le jeu ne validera ou n’invalidera pas les raisonnements du joueur : c’est à lui que revient la lourde tâche d’avoir des arguments en béton. Et c’est diablement efficace.
Au-delà de la qualité de l’histoire ou du type de récit, les PNJ qui accompagnent le protagoniste font partie des outils utilisés pour investir émotionnellement le joueur. Cependant, il est indispensable de bien mesurer le rôle et l’utilité des personnages en question. Qui n’a jamais succombé à la tentation d’abandonner Ashley à son triste sort dans Resident Evil 4 ? Surtout après avoir supporté des heures durant son cultissime « Lééééooooon !! ». À l’inverse, la série des Mass Effect représente l’un des meilleurs exemples quand on parle de qualité d’écriture. Si la série est devenue un classique vidéoludique, c’est justement grâce à l’écriture exemplaire de ses personnages, tous dotés de caractère distincts, d’expériences individuelles diverses et d’objectifs variés. Atreus dans God of War, Ellie dans The Last of Us ou Elizabeth dans Bioshock Infinite sont eux aussi de bons exemples d’acolytes réussis. On apprend à les connaitre au fur et à mesure des dialogues, on s’attache petit à petit. On les voit évoluer, changer leur vision du monde et devenir doucement plus murs. D’autant plus que tout le monde a envie de protéger les plus jeunes, symbole d’innocence dans des mondes vraiment pas jojo.
Cependant, il est à noter qu’une forme plus abstraite de narration peut aussi happer le joueur. Dans les Dark Souls, la narration se révèle erratique, avec des petits indices sur la construction du monde dissimulés un peu partout. Un décor, une description d’objet, un dialogue mystérieux : n’importe quel élément recèle une meilleure compréhension du scénario, qui, à aucun moment, n’est exposé directement. Le joueur peut terminer un Dark Souls sans avoir compris quoique ce soit à son objectif, excepté ceux concrètement imposés. C’est justement cet investissement nécessaire qui a permis à des milliers de joueurs d’élaborer des théories, de discuter entre eux, et échanger ensemble sur le jeu. Ce qui pouvait ressembler à une faiblesse s’est transformé en vecteur de curiosité, donnant ainsi une aura unique à la licence. Pour l’anecdote, cette narration particulière vient du directeur de From Software Hidetaka Miyazaki, qui lisait des livres de fantasy dont certains passages lui échappaient à cause de la barrière de la langue. Il remplissait alors les trous avec son imagination et les illustrations présentes dans le livre.
L’immersion identificatrice
Avant de rentrer plus dans le détail de l’immersion identificatrice, définissons tout d’abord la différence entre deux types de représentation du protagoniste :
- L’avatar correspond à la « représentation visuelle de la présence du joueur dans l’univers du jeu »
- L’acteur correspond au « personnage distinct du joueur, avec sa personnalité, ses caractéristiques et, jusqu’à un certain point, sa propre pensée ».
Dans les game studies, l’avatar est souvent associé aux FPS où le joueur vit lui-même les événements, tandis que l’acteur correspond aux TPS (Third Person Shooter) dans lesquels le joueur se distingue de son personnage tout en le contrôlant. Le point de vue n’est cependant pas le seul facteur influençant la relation entre le joueur et le personnage qu’il joue. Le rapport qu’entretiennent le joueur et un personnage de jeu vidéo se place entre deux postures distinctes : l’extension de soi et l’identification.
L’extension de soi suppose que le joueur se projette dans le monde fictionnel du jeu par le biais d’un avatar qu’il perçoit comme un prolongement numérique de son propre corps. Dans son livre The Routledge Companion to Video Game Studies, Jessica Aldred définit la notion d’incarnation en expliquant que le joueur considère être le personnage plutôt que de s’identifier à lui. Il ne représente donc pas une entité séparée mais bien le joueur lui-même. Jean-Marie Schaeffer nomme ce principe la « virtualisation identitaire », une posture selon laquelle « le sujet fictionnel qui se déplace dans l’univers virtuel est en fait un double du joueur réel ». Pour se faire, l’avatar doit être une coquille vide avec des traits caractéristiques peu développés – voire inexistants – ou personnalisables. Néanmoins, les chercheurs Katie Salen et Eric Zimmerman émettent une réserve sur le sujet. En effet, dans le livre Rules of Play. Game Design Fundamentals ils considèrent que le joueur demeure conscient qu’il s’agit d’une entité fictive, voyant ainsi l’avatar comme une sorte de marionnette contrôlée à sa guise. Ils appellent ça la « double conscience du joueur ».
L’identification, quant à elle, suppose que le joueur éprouve de l’empathie envers un personnage, tout en le considérant comme une entité distincte. Jean-Marie Schaeffer la nomme ainsi « allosubjectivité », qu’il définit comme l’identification « à un personnage fictif qui se déplace dans le monde fictionnel en accord avec les ordres que le joueur lui donne ». Ce processus n’est possible qu’avec des « acteurs caractérisés » dont la personnalité est prédéterminée par les concepteurs du jeu. Ses expressions et réactions doivent être perceptibles par le joueur. Les émotions dont il fait preuve ou les dégâts encaissés par l’acteur déclenchent automatiquement l’empathie chez le joueur. Grâce aux neurones miroirs, la « contagion émotionnelle » est favorisée, c’est-à-dire que le transfert des émotions d’une personne émettrice (l’acteur) vers une personne réceptrice (le joueur) est facilité.
Au-delà de ces deux postures, des « marqueurs de subjectivation » servent à renforcer la fusion identitaire entre le joueur et l’acteur. Par exemple, l’amnésie ou le mutisme du protagoniste sont des marqueurs de subjectivation fréquemment utilisés. À l’inverse, des « marqueurs d’allosubjectivité » offrent aux concepteurs des stratégies compensatoires cherchant à préserver l’altérité entre le joueur et son avatar. Par exemple, un personnage doté d’une personnalité propre (notamment à travers sa voix), l’alternance entre vue à la première et troisième personne, les cinématiques, ou encore le reflet du personnage dans un miroir permettent de créer une distance entre le joueur et l’avatar.
C’est à travers le protagoniste que l’on incarne que nous pouvons découvrir l’histoire d’un jeu, nous y plonger et participer à la construction d’un récit interactif : une spécificité du jeu vidéo procurant un engagement unique. De manière générale, l’immersion fictionnelle dans un jeu vidéo a plus de chance de se produire lorsque le personnage incarné a ses « préoccupations propres qui ne font pas simplement écho à la volonté de puissance qui anime le joueur ». L’approche avatorielle et actorielle se différencient dans ce qu’ils proposent : la première offre au joueur une grande liberté d’action et une capacité à exprimer ses préférences, tandis que la deuxième renforce la force émotive du récit. La meilleure façon d’obtenir un bon récit interactif à travers l’immersion fictionnelle consiste donc à « jouer sur les deux fronts », c’est-à-dire avoir « une mesure d’acteur dans l’avatar et une mesure d’avatar dans l’acteur ».
Ceci étant dit, abordons rapidement deux cas qui se répandent de plus en plus dans l’industrie : la capacité de créer un personnage déjà doté d’une personnalité, ou à l’inverse, la capacité de prendre des décisions à la place d’un personnage caractérisé. Par exemple, dans Mass Effect, on peut créer un ou une Shepard de toute pièce. Son physique, son background, ou encore ses capacités en combat. On peut même choisir ce qu’il va répondre dans un dialogue. Mais peut-on réellement ? en réalité, pas tout à fait : on ne peut que choisir une ligne directrice. On ne peut pas choisir les mots qu’il va employer comme dans un Fallout par exemple. Il les dit de lui-même, et parfois au détriment du joueur qui ne s’attendait pas du tout à ce genre de réponse. De fait, il a bien une personnalité distincte, contrairement au héros d’un Dragon Quest par exemple, qui est aussi vide à l’intérieur qu’une huitre un soir de noel. A l’inverse, Geralt de The witcher 3 est un personnage bien établi, avec des relations développée dans 7 bouquins et trois jeux. Il a sa propre vision du monde, ses valeurs et sa façon de réfléchir. Et pourtant, on peut décider à sa place de la personne avec qui il veut passer ses vieux jours - Yennefer bien sûr, les vrais savent -. On peut en faire une grosse brutasse, ou un mec plutôt diplomate. On influe sur sa personnalité, malgré le fait qu’il conserve son propre vocabulaire et sa propre ligne directrice.
L’immersion par le gameplay
Avant de nous intéresser spécifiquement à l’immersion à travers le gameplay, réfléchissons d’abord à la définition de ce dernier. Car oui, une question subsiste depuis l’apparition du terme dans les années 80. Sauriez-vous expliquer exactement de quoi est constitué ce qu’on appelle communément gameplay ? Si ce n’est pas le cas, c’est normal. Et si c’est le cas, il est peu probable que vous ayez pris en considération tous les critères qui le composent. Pourtant, il est fondamentalement lié au jeu vidéo. Il est constamment mis en avant par les développeurs, et traité sous tous les angles dans les critiques de jeux. La presse l’utilise de trois manières différentes :
- Reconnaître un genre de jeu à travers son gameplay. Par exemple, les JRPG dans les années 90 étaient majoritairement dotés de combats au tour par tour. Classer un jeu par son gameplay permet de créer une échelle référentielle, comprendre les inspirations des développeurs, les comparer, etc. Il permet aussi de savoir si un gameplay est innovant ou non.
- Distinguer les qualités artistiques et ses mécaniques plus profondes. Bien que le gameplay ne soit pas clairement défini, il est généralement utilisé par la critique pour parler de la maniabilité, de la synergie des mécaniques de game design et de la difficulté.
- Donner de la crédibilité à la presse spécialisée. Il est utilisé pour professionnaliser l’écriture de tests, avec des journalistes capable de discerner un bon gameplay d’un mauvais. Au point même parfois de s’adresser directement aux développeurs, pour leur faire la leçon : « Mais les programmeurs auraient mieux fait de se souvenir que le gameplay demande au moins autant d’attention que le reste. » (Edge n°3, critique de Return to Zork en décembre 1993).
Il est ainsi caractérisé de manière précise, tout en restant flou dans sa conception. Dans le lexique du site emunova, il est défini ainsi:
Terme assez précis en anglais et qui ne possède pourtant aucun équivalent en français, le gameplay c’est ce qui différencie un film d’un jeu vidéo : ce ne sont ni les graphismes, ni le son, ni les personnages, ni le scénario mais tout le reste. Le contrôle du personnage, les actions que le joueur peut effectuer, la façon avec laquelle il peut interagir avec l’environnement et, d’une façon générale, tout ce qui est sous le contrôle du joueur, c’est le gameplay. Bref le gameplay, c’est le JEU, le cœur du jeu vidéo. Le reste c’est un peu de cinéma, de littérature ou de musique.
Une définition qui n’éclaircit pas plus nos lanternes sur sa substantifique moelle, mais qui a malgré tout l’intérêt d’apporter un détail des plus significatifs : le manque de traduction en français du mot gameplay. On peut parfois le voir décrit dans la langue d’Orelsan comme la maniabilité, la jouabilité, l’expérience de jeu, la prise en main, les mécaniques, etc. Cette kyrielle de synonymes ne fait qu’ouvrir le champ des possibles pour définir le terme. Selon Greg Costikyan (créateur de nombreux jeux de rôle dont Paranoia et Star Wars), son caractère nébuleux permet aux programmeurs de se distinguer des gens du management, du marketing ou du graphisme, en sachant ce qu’est « un bon gameplay ». Certains, à l’image de Chris Crawford en 1984 dans The Art of computer Game design, tente de restreindre sa définition pour l’éclaircir :
« Le terme “game play” est utilisé depuis plusieurs années, sans qu’un consensus clair se dégage. Tout le monde est d’accord sur le fait qu’un bon game play a à voir avec la qualité des interactions du joueur. Au-delà de ça, il y a autant de significations qu’il y a d’utilisateurs du terme. Le mot perd toute valeur descriptive du fait de son ambiguïté. Je propose donc ici une signification plus précise, plus restreinte et (je l’espère) plus utile du terme “game play”. Je suggère que ce caractère insaisissable découle de la combinaison entre la vitesse et l’effort cognitif demandé par le jeu. »
Dans cette définition, le mot est divisé en deux mots, game et play. Si ce détail peut paraître anodin, il est en réalité essentiel pour comprendre son essence. Le « game » pourrait représenter le jeu en soi, l’objet physique. Celui qui délimite les règles. Le « play », quant à lui, représenterait l’activité, l’attitude ludique adoptée par le joueur. C’est à partir de ces deux visions que l’on peut analyser le jeu vidéo de deux manières différentes. D’un côté, le « game », l’application des règles : l’accessibilité, la fluidité des déplacements, les combos, les sensations de tir, etc. De l’autre, le « play », est très instructif, car dépendant de la « sensibilité du jeu à ses conditions environnementales ». Une expérience vidéoludique varie énormément en fonction de la condition de chacun. Même les jeux au gameplay le mieux rodé demeurent injouables pour une bonne partie de la population des joueurs occasionnels. Et pourtant, il n’y a pas de jeu sans joueur. Les jeux vidéo sont aussi engageants que fragiles car l’engagement ne se déduit du dispositif que si toutes les conditions sont déjà réunies.
L’immersion basée sur le défi
« Des environnements de réalité virtuelle multisensorielle pourraient fournir la forme la plus pure d’immersion sensorielle, tandis que l’expérience d’immersion imaginative serait la plus marquante lorsqu’on est absorbé par un bon roman. Les films combineraient les deux. Mais l’immersion basée sur le défi joue un rôle essentiel dans les jeux vidéo, car le gameplay exige une participation active : les joueurs sont constamment confrontés à des défis mentaux et physiques qui les incitent à jouer.
Ainsi est défini importance du gameplay dans le SCI-Model. Il décrit l’immersion basée sur le défi comme l’interaction entre le jeu et le joueur qui tente de résoudre un défi grâce à ses capacités. En plus d’être spécifique au jeu vidéo, elle peut aussi être la plus puissante, à condition d’être bien conçue. Le plus important est d’atteindre un point d’équilibre entre les habiletés du joueur et les défis proposés par le jeu. Ces derniers peuvent être divisés en deux catégories :
- L’habilité sensorimotrice, qui repose sur la dextérité dans la manipulation du dispositif (généralement une manette), ses réflexes et sa coordination.
- La capacité cognitive, qui repose sur la compréhension et l’analyse des règles du jeu.
Les jeux dotés d’un rythme rapide, comme les jeux de course ou les Fast FPS, représentent un bon exemple de l’habilité sensorimotrice exigée envers le joueur lors d’une partie. Ils demandent une concentration extrême pour ne pas finir dans le décor, ou avalé tout cru par un démon. Les jeux qui utilisent la capacité cognitive sont des jeux plus lents, et demandent souvent d’apprendre des tonnes de mécaniques parfois contre-intuitives à travers une interface illisible pour un néophyte. Mais une fois maîtrisés, ils procurent une sensation de domination, tel un génie du mal régnant sur le monde. L’implication du joueur se joue donc sur la prise de décision, qui doit être à la fois réfléchie et anticipative.
Étrangement, le gameplay devient totalement immersif lorsqu’il est invisible. Lorsque la caméra réagit correctement dans un TPS, lorsque les combo deviennent instinctif dans un jeu de combat, lorsque l’on sait où trouver chaque petit détail utile dans une interface de jeu de gestion. Et ça passe aussi par l’interface : des menus et des HUD diégétiques (comme dans Metroid Prime ou Nier Automata) favoriseront l’immersion du joueur. Le personnage voit les mêmes choses que le joueur, créant une connexion d’autant plus forte que ces éléments ne rappellent pas au joueur qu’il est derrière un écran. L’exemple le plus connu, Dead Space, intègre chaque élément du HUD de manière à provoquer l’effet de surprise. Car si la colonne vertébrale montre la vie, le nombre de munitions est affiché sur l’arme, la carte est un hologramme que Isaac regarde, les développeurs savent à peu près où le joueur regarde, leur permettant d’insérer des événements dans la périphérie du regard, et donc créer la peur.
Cependant, Il faut bien prendre en compte qu’un gameplay réussi et immersif ne veut pas nécessairement dire un gameplay amusant. Dans Papers Please, on joue un douanier dans un pays communiste fictif. Il est demandé au joueur de simplement vérifier les papiers d’identité de ceux se présentant à votre guichet, pour valider ou refuser leur entrée au pays. Sauf que des règles vont s’ajouter au fur et à mesure, rendant la décision de plus en plus difficile à prendre, tout en exigeant de vérifier de plus en plus de détails. Bien entendu, votre salaire dépendra du nombre de dossiers traités. Le jeu est répétitif, injuste, et parfois difficile, mais c’est le but : toutes ces caractéristiques servent en fait à immerger le joueur dans un boulot réellement difficile.
Le tout est de réussir à trouver un juste équilibre entre pénibilité du gameplay et difficulté. Car à trop vouloir immerger le joueur, certains studios obtiennent un effet contre-productif. Dans le mode Ranger de la série Metro, tous les éléments du HUD sont désactivés, comme les munitions ou le temps d’oxygène qu’il reste avant de changer le filtre du masque à gaz. Le joueur est ainsi bien plus méfiant, modifiant de fait sa façon de jouer. Et surtout, supprimer tous les indices montrant les interactions possibles rend le jeu bien moins agréable à jouer. Tout est question d’équilibre. Par exemple, les limites de poids ou la durabilité des armes peuvent apporter un sentiment d’immersion, mais peuvent aussi créer une frustration qui produit l’effet inverse.
Le Flow
Pour qu’un jeu immerge le joueur, il nécessite un bon équilibrage entre gameplay et difficulté. Un des outils les plus répandus pour y parvenir se trouve dans la représentation des courbes d’apprentissage et de découverte : elle permet de gérer la difficulté du jeu en prenant en compte l’apprentissage du joueur. La difficulté est ainsi gérée en rajoutant à certains moments clés de nouvelles mécaniques. Un outil inventé dans la théorie du bonheur, présentée dans le livre de Mihály Csíkszentmihályi, Vivre, La psychologie du bonheur. On y découvre le concept d’expérience optimale, qui représente une des clés de voûte du maintien de l’immersion vidéoludique.
Selon Csíkszentmihályi, le bonheur naît par le biais de l’effort : c’est dans la réalisation d’un challenge physique et/ou mental que nous pouvons l’atteindre. Au cours de ses études, Csíkszentmihályi a interrogé de larges panels de sujets pour comprendre ce qu’ils font lorsqu’ils ressentent de l’enchantement. Si la variété d’activités est grande, la description du sentiment et des raisons de son émergence sont, elles, les mêmes pour quasiment toutes les activités. Il en a conclu que :
L’engagement dans une tâche précise (un défi) qui fournit une rétroaction immédiate, qui exige des aptitudes appropriées, un contrôle sur ses actions et une concentration intense ne laissant aucune place aux distractions ni aux préoccupations à propos de soi et qui s’accompagne (généralement) d’une perception altérée du temps constitue une expérience optimale. Cette dernière entraîne des conséquences très importantes : meilleure performance, créativité, développement des capacités, estime de soi et réduction du stress. Bref, elle contribue à la croissance personnelle, apporte un grand enchantement et améliore la qualité de vie.
Les activités susceptibles de provoquer l’expérience optimale sont qualifiées d’« autotéliques » par Csíkszentmihályi. Le terme vient de deux mots grecs, « auto » qui veut dire « soi » et « telos » qui signifie « but ». Une activité autotélique correspond donc à une activité qui est une fin en soi, que l’on ne pratique pas pour ce qu’elle offre comme conséquences. Néanmoins, elles doivent disposer de huit composantes majeures pour créer l’expérience optimale :
- La tâche proposée par l’activité est réalisable, tout en restant un défi reposant principalement sur l’utilisation d’une aptitude spécifique.
- L’individu est concentré sur la tâche qu’il accomplit.
- La cible visée est claire.
- L’individu reçoit une rétroaction immédiate de la part de l’activité en cours.
- Toute distraction se voit éliminée par l’engagement profond de l’individu dans la tâche.
- L’individu exerce un contrôle sur ses actions.
- La préoccupation de soi disparaît au cours de la réalisation de la tâche, mais, paradoxalement, le sens du soi est renforcé une fois le sentiment d’enchantement perçu par l’individu.
- L’individu perçoit le temps de manière altérée.
Pensons maintenant ces éléments pour l’immersion vidéoludique. Jenova Chen, connu principalement pour Flower et Journey, apporte une application concrète de la théorie du flow au jeu vidéo. Dans sa thèse Flow in game, il propose des outils – qu’il a appliqué dans ses propres jeux – pour créer une activité de jeu conçue autour du concept du flow. Pour ce faire, il part des huit caractéristiques majeures de l’expérience optimale et les revisite pour les appliquer au game design. En émergent trois éléments principaux :
- Le jeu doit tout d’abord être intrinsèquement enrichissant, et le joueur doit être prêt à entrer dans le jeu.
- Le jeu doit offrir le bon niveau de défi par rapport aux capacités du joueur.
- Le joueur doit avoir un sentiment de contrôle sur l’activité de jeu.
Avec ça, le jeu fera perdre la conscience du soi et altérera la perception du temps (deux caractéristiques majeures de l’expérience optimale). Sauf que l’accession à l’expérience de flow reste unique à chaque personne. Un jeu pensé pour un joueur « moyen » ne satisfera ni un novice ni un expert. Le premier sera trop rapidement dépassé par le challenge, tandis que le deuxième s’ennuiera vite. Pour réussir à ajuster le degré de difficulté, Chen propose trois méthodes :
- Agrandir la zone de flow en incluant un spectre plus large de gameplay comprenant différentes difficultés et différents ressentis.
- Créer un système dynamique d’ajustement de la difficulté permettant à différents types de joueurs de jouer à leur manière.
- Inclure les choix proposés par la difficulté dynamique dans le cœur de gameplay, et laisser le joueur faire ses propres choix durant le jeu.
Un des points essentiels à la mise en place de ces méthodologies réside dans le fait qu’elles doivent être mises en avant de façon évidente. Le joueur ne doit pas éprouver de difficultés à identifier ces différentes expériences, pouvant ainsi choisir celle qui lui correspond. Par exemple, dans The Walking Dead de Telltale, le jeu propose de choisir entre deux styles d’expérience avant même de commencer l’aventure. On peut jouer avec un grand nombre de feedbacks et d’assistances – mettant en avant les détails des interactions – ou jouer avec le moins d’aides et d’informations possibles. On pourrait croire qu’il s’agit juste d’un choix de niveau de difficulté, mais ce sont bien deux expériences différentes. La première met en avant des mécanismes de gameplay, permettant ainsi une réelle maîtrise du jeu. Ce qui ressemble à une aide accentuée peut aussi se révéler utile aux attentes de certains joueurs expérimentés.
Pour finir, il est important de prendre en compte le fait que le flow peut être investi par tous les corps de métiers de jeux vidéo. Un game designer peut réfléchir à l’agencement des mécaniques. Un animateur peut imaginer des effets visuels spécifiques (Temper est un excellent exemple d’effets visuels immersifs). Un scénariste peut raconter une histoire aux rebondissements inattendus. Un level designer doit penser l’architecture des niveaux de façon à ce que le joueur ne soit jamais perdu. Bref, vous l’aurez compris, la création du sentiment de flow dépend d’une somme d’éléments qui doivent se réunir en un point culminant.
Conclusion
L’immersion, qu’elle soit fictionnelle ou non, est un sujet sacrément vaste. Dans le jeu vidéo, elle se crée à partir de mécaniques bien précises. Et c’est justement ça qui rend le médium si intéressant : de nombreuses possibilités sont offertes aux créateurs comme aux joueurs. À travers la beauté des graphismes, d’une histoire riche, d’un gameplay précis ou de règles de jeu bien établies, quelqu’un de curieux pourra toujours trouver chaussure à son pied. La richesse du jeu vidéo lui vient de sa diversité et de sa façon de placer celui qui l’expérimente au centre de l’expérience.
Bien entendu, l’immersion vidéoludique est un sujet aussi riche que vaste. Dans cet article ne sont pas abordés l’immersion sociale développée dans les MMORPG; la réalité virtuelle, qui redéfinit totalement l’immersion sensorielle; les différents outils utilisés pour renforcer physiquement l’immersion, avec par exemple Kinect, la Wiimote, la guitare en plastique de Guitar Hero, ou plus communément les vibrations de la manette. Et quid des jeux en FMV comme Her Story ? De la réalité augmentée ? des jeux en réalité alternée ? Il y a encore beaucoup à dire, et tant d’autres possibilités à explorer.
Mais le but de l’article n’est pas d’être exhaustif – auquel cas il faudrait en réalité écrire un livre sur le sujet – mais de présenter quelques études et de poser les bases initiales de ce qui crée l’immersion. D’ailleurs, j’ai omis quelques chercheurs importants pour ne pas alourdir la lecture, mais il est important d’évoquer malgré tout les travaux de Gordon Calleja, et notamment son livre In-Game: From Immersion to Incorporation. Dans ce dernier, il définit un modèle holistique qui prend en compte à la fois l’expérience subjective du joueur et les aspects formels du jeu, tout en considérant différentes variables interagissant entre elles pour créer l’immersion. Abordons également Marie-Laure Ryan, une auteure prolifique qui a par ailleurs inspiré Arsenault et Picard avec ses livres Narrative as Virtual Reality et Avatars of Story.
J’ose espérer qu’après la lecture de cet article, vous aurez accès à de nouveaux axes de réflexion. Peut-être bien que la prochaine fois que vous jouerez à un jeu, vous réfléchirez aux mécaniques immersive qui vous permettent de l’apprécier ?
Pour aller plus loin :
- Hamlet on the Holodeck, Janet Murray
- Qu’est-ce que la fiction ?, Jean-Marie Schaeffer
- Fundamental Components of the Gameplay Experience: Analysing Immersion, Laura Ermi et Frans Mäyrä
- Immersion, engagement, and presence: A method for analyzing 3-D video games, Alison Mcmahan
- The Video Game Theory Reader, Mark J.P. Wolf et Bernard Perron
- In-Game: From Immersion to Incorporation, Gordon Galleja
- Flow in game, Jenova Chen
- La Fabrique des jeux vidéo, Mathieu Triclot
- Rules of Play. Game Design Fundamentals, Katie Salen et Eric Zimmerman
- I Have No Words & I Must Design: Toward a Critical Vocabulary for Games, Greg Costikyan
- Narrative as Virtual Reality, Marie-Laure Ryan
- Avatars of Story, Marie-Laure Ryan
- The Art of Computer Game Design, Chris Crawford :
- Vivre, La psychologie du bonheur, Mihály Csíkszentmihályi
- Le jeu vidéo entre dépendance et plaisir immersif : les trois formes d’immersion vidéoludique, Dominic Arsenault et Martin Picard
- Le potentiel critique des jeux vidéo, Christophe Remy
- Illusion, idéalisation, gratification : l’immersion dans les univers de fiction à l’ère du jeu vidéo, Carl Therrien
- De l’immersion à l’engagement, la perspective des concepteurs de jeux vidéo sur l’expérience de jeu, Pierre-Luc Chabot
- L’immersion fictionnelle dans le jeu vidéo, Fanny Georges
- Métapsychologie de l’immersion dans les jeux vidéo, Yann Leroux
- Immersion dans un monde virtuel : jeux vidéo, communautés et apprentissages, Etienne Armand Amato
- L’immersion fictionnelle au-delà de la narrativité, Gabrielle Trépanier-Jobin et Alexane Couturier
Ça pourrait vous intéresser :







